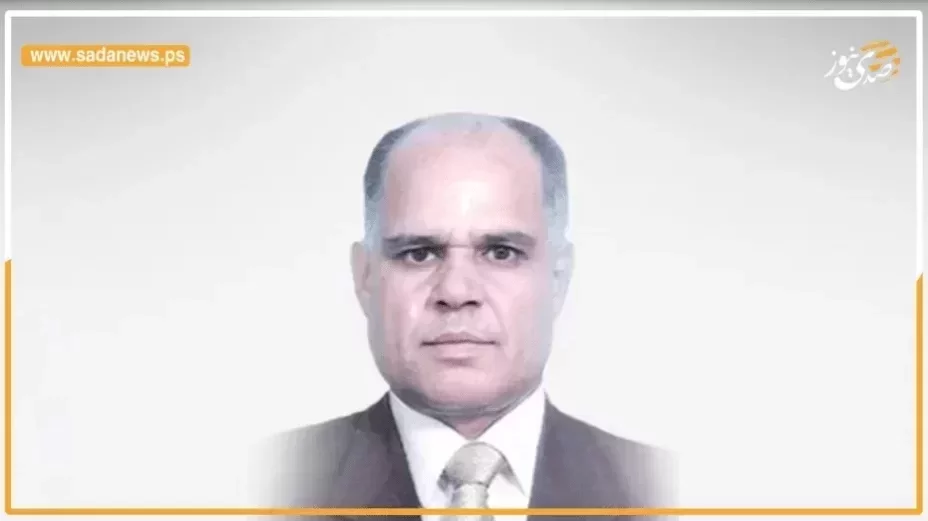
Entre la proclamation de l'État palestinien en 1988 et sa réalité aujourd'hui
En ce jour de 1988, le président défunt Arafat a annoncé, lors du Conseil national à Alger, le document de proclamation de l'indépendance de l'État de Palestine sur les terres palestiniennes, avec la reconnaissance et l'engagement envers toutes les résolutions de la légitimité internationale. Cela a marqué le passage de la légitimité révolutionnaire et historique à la légitimité internationale et d'une approche de libération par la résistance armée à un pari sur les négociations et le règlement politique.
À l'époque, Washington a ouvert une ligne de communication directe avec les Palestiniens en Tunisie, mais a refusé que la délégation palestinienne soit sous le titre ou représentante de l'État de Palestine. Ils ont plutôt accepté de négocier avec l'Organisation de libération de la Palestine, qu'ils considéraient comme une organisation terroriste, alors que l'organisation menait des actions de résistance en Palestine et à l'étranger, représentant un mouvement de libération nationale !
Lors de la tenue de la conférence de Madrid en 1991, la présence d'une délégation représentant l'État de Palestine a également été refusée, et ce n'est qu'après des hésitations qu'une délégation représentant l'organisation a été acceptée, mais seulement depuis les territoires occupés. À Oslo, les négociations avaient lieu entre Israël et l'organisation, tout comme la signature de l'accord à Washington entre les deux parties, jusqu'à ce que le document de reconnaissance mutuelle stipule que l'Organisation de libération reconnaîtrait l'État d'Israël en échange de la reconnaissance par ce dernier de l'Organisation de libération comme représentante des Palestiniens, et non comme une reconnaissance d'un État à un autre.
Dans les textes de l'accord d'Oslo, le mot "État palestinien" ou "terrains palestiniens occupés" ne figurent pas, et même la base sur laquelle l'accord a été établi n'était pas l'ensemble des résolutions de la légitimité internationale, comme l'affirmait et le demandait l'Organisation de libération, mais seulement les résolutions 242 et 338 du Conseil de sécurité, qui ne sont pas contraignantes, afin d'éviter la résolution de partage 181 et la résolution sur le retour des réfugiés 194.
Avec l'approche de la fin de la phase de transition de l'accord d'Oslo en mai 1999, où les négociations sur les questions de statut final devaient commencer, et alors qu'Israël se dérobait aux négociations, Arafat a laissé entendre qu'il envisageait de déclarer unilatéralement l'État palestinien sur les frontières de 1967. Mais Washington a menacé Arafat, en cas de prise de cette décision, d'imposer des sanctions sévères avec Israël jusqu'à mettre fin à l'existence de l'Autorité palestinienne. Ils ont également demandé à des pays arabes, en particulier à l'Égypte, de faire pression sur Arafat, et en effet l'Égypte a menacé, à travers un appel téléphonique intense entre le président Moubarak et Arafat, qu'elle ne reconnaîtrait pas l'État de Palestine s'il était proclamé unilatéralement !
Washington a accepté de reconnaître l'Organisation de libération de la Palestine, qui est considérée par les États-Unis comme une organisation terroriste, et a ouvert un bureau pour elle aux États-Unis et a communiqué avec ses dirigeants. Arafat a même visité la Maison Blanche plusieurs fois et a rencontré des présidents américains, ce que le président Mahmoud Abbas a également fait. Cependant, ils refusent de reconnaître un État palestinien sur une seule parcelle de terre palestinienne, même lorsqu'elle est sous occupation et désarmée ! La principale raison de ce refus est le manque de reconnaissance que la Cisjordanie et la bande de Gaza sont des territoires occupés ; ils les traitent comme des terres disputées.
Aujourd'hui, après 37 ans depuis la proclamation de l'indépendance, on peut expliquer le comportement israélien en Cisjordanie et le comportement américain dans la bande de Gaza et leur refus de reconnaître l'État palestinien parce que depuis la conférence de Madrid de 1991 puis Oslo de 1993, les deux pays ne considèrent pas que la bande de Gaza et la Cisjordanie sont des terres palestiniennes occupées, mais des terres disputées, ce qui a encouragé Israël à poursuivre les colonies au point de désigner la Cisjordanie comme Judée et Samarie, une partie de la terre d'Israël, et à commencer à l'annexer. C'est aussi ce qui a incité Trump à envisager de déplacer les habitants de la bande à en faire une station balnéaire et à agir dans la bande avec l'accord israélien, car pour lui, la bande est une terre sans propriétaire et disputée.
Certains pourraient dire que Trump a déclaré son refus d'annexer la Cisjordanie par Israël. C'est vrai, mais en même temps, il ne reconnaît pas l'État palestinien en Cisjordanie et n'a jamais dit que la Cisjordanie est une terre palestinienne occupée ; il avait déjà reconnu Jérusalem comme capitale d'Israël et transféré l'ambassade américaine, tout en continuant à traiter la Cisjordanie et la bande de Gaza comme des terres disputées.
D'autres pourraient également dire qu'un bon nombre de décisions internationales reconnaissent la Cisjordanie, Jérusalem et la bande comme des territoires occupés, tout comme l'Assemblée générale des Nations Unies a reconnu la Palestine comme État observateur en 2012 et ensuite environ 160 pays ont reconnu l'État de Palestine.
Bien que l'importance de ces décisions et de ces reconnaissances soit indiscutable, aucune décision internationale n'est contraignante et elles restent plus proches de recommandations. Et aujourd'hui, dans le contexte de l'hégémonie américaine, la légitimité internationale n'est plus une référence pour le retour des droits aux propriétaires, et elle a même perdu sa capacité à résoudre les conflits par des moyens pacifiques ; la force et les intérêts internationaux l'emportent sur la légitimité internationale. Malgré cela, le droit du peuple palestinien ne se perdra pas, et le monde se mobilise en notre faveur, sachant que la force et ses équilibres ne sont pas fixes, et la carte la plus forte que possède le peuple palestinien est sa résistance et sa persévérance sur sa terre, où le nombre de Palestiniens dépasse celui des Juifs, ce qui met l'État de l'entité devant deux choix, tous deux amers pour elle : soit se séparer d'eux, ce qui conduira à un État palestinien, soit annexer et occuper, ce qui fera perdre à l'État son identité juive et le transformera en un État raciste. Même l'initiative de Trump ne résoudra pas le problème et n'apportera pas la paix, ni à Gaza, ni en Palestine, ni au Moyen-Orient.

Entre "Ici Jérusalem" et "Ici Gaza"... La voix d'une nation et la résistance d'un peuple

Alors que certains comptent les huées, les Palestiniens comptent leurs martyrs... Les para...

Lorsque la question palestinienne est réduite à la gestion de Gaza

Occupation légalement autorisée

Absence des Palestiniens et mise sur le temps

Palestine : Quand le criminel est désigné comme "faiseur de paix"

Ne rendez pas le peuple palestinien responsable de l'échec de vos systèmes et idéologies

